Dans la conclusion de son
analyse statistique du vocabulaire de Racine, Charles Bernet exprime le
désir que son étude fournisse « un point de départ à des recherches plus
limitées qui la complèteront ». C’est en partie dans cette perspective que j’ai abordé la question de l’hapax legomenon chez Racine.
Commençons par quelques critères, et par quelques statistiques.
i) J’ai considéré le corpus tragique de Racine exclusivement, sans tenir compte des Plaideurs ou de l’œuvre poétique. Il existe quelques exemples d’hapax
(soit 84) dans le théâtre tragique, qui ne mériteraient pas ce statut
dans l’ensemble de l’œuvre de Racine, aussi bien qu’une grande
proportion d’hapax dans l’œuvre non-tragique, dont une forte occurrence
dans Les Plaideurs.
ii) J’ai compris dans les chiffres les variantes (12 exemples d’hapax), y compris celles, relativement plus importantes, de La Thébaïde, Alexandre et Britannicus (7 dans La Thébaïde et Alexandre, et 3 dans Britannicus III, i), ainsi que le prologue d’Esther (9 exemples).
iii)
Je n’ai pas considéré comme hapax tout vocable qui existe dans une
forme grammaticale particulière, si d’autres formes sont également
présentes : ainsi ne sont pas compris rame / rames ou déployé / déployez ; ni même quand la forme grammaticale est différente, ainsi ample / amplement ou arabe / Arabie.
En revanche, j’ai considéré comme hapax un vocable dont il existe une
autre forme étymologiquement liée, mais grammaticalement et
phonétiquement distincte, ainsi dévotion / dévouer, ou affliction / affliger. Dans une catégorie intermédiaire, j’ai admis comme hapax mûr, sec et rouge, malgré la présence de leur formes verbales, mûrir, sécher et rougir.
Si ces définitions sont admises, il reste, sur les 475 hapax du théâtre tragique cernés par la Concordance, 460 exemples. Ces exemples se subdivisent ainsi en catégories grammaticales :
noms : 269
|
noms propres : 95
|
noms communs : 174,
dont concrets : 121 / abstraits : 53
| |
verbes : 128
|
formes verbales : 94
|
formes adjectivales : 34
| |
adjectifs : 57
| |
autres : 6.
|
De
plus grands raffinements de définition seraient certes possibles, mais
le but de ces chiffres est l’interprétation, et c’est dans cette
perspective qu’ils seront utilisés
D’autres
statistiques sont tout de suite frappantes, dont je tirerai des
remarques plus étendues. D’abord, que les trois dernières pièces ont de
très loin les occurrences d’hapax les plus importantes (Phèdre, 87 ; Esther, 66 ; Athalie, 109 — et si, par hypothèse, nous rapportions Esther proportionnellement à sa relative brièveté, nous trouverions qu’elle atteint à peu près le chiffre d’Athalie) ; et que parmi les autres pièces, c’est Britannicus qui prédomine (47). La pièce la plus riche en hapax adjectivaux est Phèdre (19), aussi bien qu’en formes adjectivales de verbes (11) — et l’on pourrait d’ailleurs constater que Phèdre est la pièce où les différentes catégories grammaticales d’hapax sont les mieux distribuées ; Mithridate est relativement riche en noms propres (12), Esther
relativement pauvre (7). Compte tenu de ces chiffres, Bernet divise les
pièces en trois catégories avec une précision statistique à laquelle je
ne saurais atteindre, et en se fondant sur quelques critères
différents, mais avec un résultat identique, à savoir : i) les pièces de
La Thébaïde à Iphigénie, avec l’exception de Britannicus : « ces pièces sont donc celles dont le vocabulaire se distingue le moins du “fonds commun? racinien » ; ii) Britannicus ;
iii) les trois dernières pièces, à propos desquelles il note que « les
“vocables rares? qui apparaissent dans ces pièces sont pour une grande
part des mots concrets ».
Deux autres faits frappent au premier abord : qu’un pourcentage assez
élevé d’hapax se trouve aux premiers actes — 127 exemples au total (+ 9
dans le prologue d’Esther) ; et que deux catégories étymologiques marquées par les préfixes se signalent par leur fréquence : les adjectifs en in- ou im- ; les verbes en dé- et en re- ou ré-. Nous pouvons maintenant en tirer quelques interprétations, afin de parvenir à la définition de certaines catégories.
L’hapax expositionnel et de spécificité
Le
taux élevé de noms propres et de noms concrets nous permet déjà de
constater que l’hapax prête un élément de précision, de réalité physique
au vocabulaire racinien. Il semble peu surprenant alors qu’un nombre
significatif d’hapax se trouve au premier acte, à l’acte de l’exposition
formelle, où un contexte chronologique et spatial est nécessairement
établi. Les noms (86), en particulier les noms propres (39) et les noms
concrets (35), y figurent notamment, parmi lesquels les noms de lieux et
de personnages historiques et mythiques sont les plus nombreux. Mais
certains vocables particuliers à l’ethos de la pièce sont également des hapax nominaux de premier acte, dont commerce, surveillants et malignité (Britannicus) ; cabinet (Bérénice) ; poupe et inclémence (Iphigénie) ; auxquels nous pourrions ajouter les hapax verbaux déshériter, avilir et trafiquer (Britannicus) ou faillir, s’exhaler et transir (Phèdre), établissant dès le début une consonance avec les motifs et les particularités de ces pièces.
Étroitement
lié à cette première catégorie est l’hapax de spécificité, qui explique
dans une grande mesure la vaste croissance d’hapax dans les tragédies
bibliques. Nous n’avons qu’à regarder quelques exemples de mots à deux
emplois, pour voir comment cette dimension de spécificité est également
fournie par d’autres éléments lexicaux à occurrence rare : ainsi océan et rivières (Alexandre), deuil et enlacés (Bérénice) édifice (Athalie).
Dans une moindre mesure dans les autres tragédies, les hapax mots-clés
(après le premier acte) confirment cette impression, ainsi démêlé (La Thébaïde), escadrons (Alexandre), gladiateur (Mithridate) et voûtes (Phèdre). Et les hapax de Mithridate,
où les questions territoriales sont privilégiées, reflètent cette
dimension par les noms propres géographiques. Mais c’est dans ses
dernières pièces, où Racine aborde un autre domaine de sources, l’Ancien
Testament, que les hapax fournissent une plus vaste étendue de
références, faisant appel alors au contexte biblique : d’abord en ce qui
concerne le décor (dans le sens le plus large du terme) : concert, jardin, noces, salon (Esther) et seuil (Athalie) ; mais aussi les rituels (païens aussi bien que judaïques) : annales, cilice, vin (Esther) et mitre, sel (Athalie), et les concepts proprement religieux : jeûne, libations, louanges (Esther), chérubins, ferveur, holocauste, pacte, superstitions et tabernacle (Athalie) ; enfin les verbes dédier, prédestiner et sanctifier sont tous des hapax du prologue d’Esther .
Mais c'est quoi un hapax ? La réponse par là...
La quincaillerie paresseuse remercie tout particulièrement Richard Parish pour ses recherches sue les hapax chez Racine !

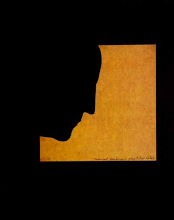



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire